| Introduction | La respiration | La posture | L'émission | Les lèvres | Pédagogie |
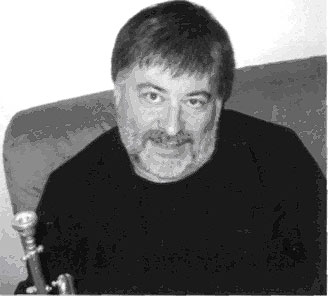 Cet article s’adresse principalement aux musiciens pratiquant des instruments à embouchure. Ceux-ci utilisent deux membranes qui font partie intégrante de notre corps : les lèvres. Mais les autres instrumentistes à vent se servant de leur bouche pour pratiquer, peuvent lire aussi ces quelques lignes en comprenant que toute action crispée et volontaire sur cet endroit du corps conduit aux mêmes effets cité ci-dessous.
Cet article s’adresse principalement aux musiciens pratiquant des instruments à embouchure. Ceux-ci utilisent deux membranes qui font partie intégrante de notre corps : les lèvres. Mais les autres instrumentistes à vent se servant de leur bouche pour pratiquer, peuvent lire aussi ces quelques lignes en comprenant que toute action crispée et volontaire sur cet endroit du corps conduit aux mêmes effets cité ci-dessous.
Le travail des lèvres, prend une place trop importante dans le jeu de certains musiciens. Ils s’enferment dans une recherche de différentes postures de celles-ci afin d’en moduler la pince, en fonction des changements de tessiture. Cette préoccupation occulte bien souvent le processus principal de réalisation sonore basé sur "la respiration décontraction" dont nous avons parlé dans les pages précédentes. Ces différentes postures créent une contraction des muscles de la face, nuisible à une aisance de jeu instrumental. L’embouchure vient plus ou moins écraser les lèvres. On parle dans ces cas là de "jeu sur la gueule". Celui-ci conduit très vite à une fatigue physique du musicien, à une perte de justesse initiale (le son monte) et une différence de facture sonore. Les corrections sont toujours possibles mais que de complications, de fragilité, et de manque de confiance en soi.
Tout ceci Monsieur Robert Pichaureau l’avait vécu dans ses débuts de trompettiste. Il a eu l’intelligence de se remettre en question et de s’explorer de la tête aux pieds, et nous le faire partager. On ne le remerciera jamais assez. Comme dans les pages précédentes j’essaie de vous traduire par écrit ce qu’il préconisait dans ses cours et que je vis encore aujourd’hui. Je fais référence également au journal Médecine des Arts n°8 (juin1994) déjà cité dans l’introduction. Le constat médical physiologique réalisé par un collège de professeurs de la Faculté Pitié Salpetrière de Paris a révélé un appui peu important et régulier de l’embouchure sur mes lèvres. En effet, pour un même exercice d’arpèges grave-aigu-grave la pression exercée sur les lèvres est de 0,5 kg sur l’aigu pour moi, elle est de 3 kg pour l'autre instrumentiste. Le "traumatisme" (terme médical) supporté par les deux lèvres et les dents ne sera forcément pas identique. Les conséquences seront beaucoup plus amplifiées dans le second cas. Réfléchissons donc sur la procédure la plus favorable à un jeu durable et sans souffrance inutile.
Nous constatons que le bruit du son perçu à la sortie de l’instrument est le résultat de l’amplification d’une vibration qui se forme grâce aux deux membranes "lèvres". On peut la comparer au bruit que fait le vol du moustique. Mais cette vibration ne doit pas être acquise par une pression musculaire de l’une sur l’autre avec une idée de fermeture à forcer, mais par un passage d'air chaud (comme celui du chant) entre les deux membranes raffermies. Pour illustrer mes propos je prends l’exemple d’une conversation : "bonjour, peut-être partiras-tu à Paris ?" Si vous insistez sur les consonnes en étant trop attentionné sur le départ de chaque phrase ou mot, vous risquez d’obtenir une conversation hachée, postillonante et fort peu mélodieuse : "Bonjour, Peut-être Partiras-tu à Paris ?" Le fait de se concentrer sur le départ de la prononciation crée ce problème. C’est le "pou" de l’instrumentiste à embouchure qui a remplacé le fameux "tu" des anciens, obtenu par le retrait rapide de la langue positionnée entre les lèvres comme pour retirer le brin de tabac collé sur celles-ci. Cette façon de faire a de moins en moins cours heureusement, mais le "pou" de remplacement reste tout de même dangereux car il suppose une fermeture des lèvres au préalable qui ne s’ouvriront que par une force de sortie sous pression. Cela va à l’encontre de tout ce que j’ai expliqué dans les pages précédentes.
.
Certes, la position de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure est à considérer, mais à la même valeur de préoccupation que lorsque l’on siffle. Exemple siffler en travaillant. Cependant: certaines personnes n’arrivent pas à siffler soit parce qu’elles forcent sur le rond musculaire soit parce qu’elles le relâchent trop. Il faut trouver un juste milieu. Et, souvent, pendant ce moment de recherche les gens ont tendance à bloquer leur respiration par effet de contraction attentive. Lors de problèmes de pince, il ne faudrait jamais travailler les lèvres isolément du reste des mouvements corporels respiratoires.
Nous allons donc détailler cette partie extérieure du corps qui est la première à être en contact physique avec l’instrument. La partie de l’instrument à être en contact avec le corps s’appelant l’embouchure.
D’un côté nous observons une masse de chair vivante, en deux parties, constituées de muscles irrigués par de multiples petits vaisseaux sanguins, le tout reposant sur les dents. De l’autre un seul élément, masse métallique (le plus souvent) cercle inerte et dur. Cette première comparaison s’appuyant sur la simple description de la matière de ces deux éléments, laisse présager lors de leur rencontre une "défaite pénible et douloureuse de la chair sur le métal". Certains trompettistes au cours de leur histoire en ont fait les frais (courbatures des lèvres, opérations chirurgicales etc.). Donc il devient très important d’adopter une posture des lèvres pour les placer dans un état de pince le plus efficace, le plus confortable, et le plus durable possible. Je rappelle auparavant que la pratique instrumentale est un des épanouissements artistiques auquel peuvent se livrer les êtres humains, et non une souffrance physique dont le résultat et la valeur artistique se mesureraient à celle-ci.
Pour ce faire, il est logiquement nécessaire de rassembler un maximum de chair, donc de muscles dans un cercle concentrique afin de recevoir le cercle métallique de l’embouchure. Louis Maggio illustre très bien cela avec la photo d’un chimpanzé vu de face. Les deux lèvres se rassemblent, les deux commissures ont tendance à se resserrer (fig.a). On peut y voir l’image d’un volcan. Ce qu’il faut éviter, c’est l’écartement des commissures pour former une pince qui ressemblerait à une paire de tenailles (fig.b).

On peut également imiter la posture d’appel d’un petit animal pour mettre rapidement les deux lèvres en position.
L’action de l’embouchure doit être réduite à une simple réception des vibrations. J’appelle celle-ci "lavabo à réception de vibrations". Bien entendu la forme de ce "lavabo" agit sur la facture sonore. La profondeur, la largeur de cuvette, ses rebords, le grain et l’évasement intérieur de la queue ont leur incidence sur la conduction des vibrations dans le tuyau qui se trouve derrière (trompettes, cors, trombone, tubas…).
Cela étant acquis, pour éviter de garder à l’esprit ce "problème" de vibrations ("pourvu que j’aie une vibration à l’instant T") on ne doit pas chercher à la réaliser (cela paraît aberrant ! et pourtant…). Pour mieux comprendre, revenons sur la production du son avec notre voix. Au moment de parler, les cordes vocales fonctionnent sans pour autant que nous cherchions spécifiquement à les faire vibrer. Le passage de l’air chaud retenu est suffisant. Plus nous retenons, plus la vibration est mélodieuse. (voir pages précédentes). Malheureusement certains métiers utilisant la parole peuvent nous conduire à une dérive qui sans y prendre garde, nous abîment les cordes vocales jusqu’à l’extinction de voix : le professeur des écoles par exemple. Il aura trop insisté musculairement et volontairement sur sa gorge. Il n’aura pas suffisamment retenu son souffle. On dit qu’il se sera extériorisé et qu’il aura saturé le passage entre ses cordes vocales.
Me basant sur cette comparaison, je préconise dans un premier temps de chanter un "U" très profond, donc de mettre en vibration les cordes vocales juste avant de mettre en vibration les lèvres, en les rapprochant comme indiqué plus haut. Garder les deux sons dans un premier temps. Le constat est que l’esprit est moins sur la vibration des lèvres. La volonté de les faire vibrer est moins prégnante. Si on ne peut réaliser les deux sons en simultané cela veut dire que l’on utilise trop d’air, qu’il n’est pas retenu (ref. travail du diaphragme). Dans un deuxième temps il faudra essayer de changer la tessiture du son de la trompette sans pour autant faire bouger la hauteur du chant. Cela ne vient pas facilement au premier essai mais il faut insister journalièrement, et gagner petit à petit de la tessiture instrumentale. Il ne faut pas chercher à donner de la couleur au chant. Les cordes vocales doivent fonctionner d’une manière la plus lâche possible. Le mieux est d’imiter un râle s’approchant d’un son grave relatif à chaque personne sans grattement des cordes vocales. Pendant tout ce temps de travail il est important de garder les lèvres rassemblées comme indiqué sur le croquis ci-dessus. Les sensations corporelles internes sont à découvrir et à imprimer dans notre subconscient afin de les répliquer sans utilisation des cordes vocales.
Pour mieux comprendre la vibration des lèvres, il est intéressant de comparer le passage de l’air chaud au rebond d’une balle en caoutchouc. Celle-ci rebondira très rapidement sur une surface dure, mais retombera sans rebond sur une surface molle. D’où l’intérêt d’avoir les lèvres fermes pour que l'air chaud puisse rebondir et former la vibration. D’où malheureusement l’instinct de l’appui de l’embouchure sur celles-ci. En effet l’appui durcit et tend les deux membranes. Ceci est absolument à prohiber si l’on veut perdurer dans le jeu, posséder un aigu ou suraigu facile et non aléatoire.
Comme vous le constatez, on ne doit pas travailler la partie "mécanique pince" en la dissociant du reste du corps.
En résumé il faut poser l’embouchure sur des lèvres rassemblées, fermes, et non hermétiquement collées, puis utiliser le souffle du chant afin que la vibration se réalise. A partir de là il faut s’éloigner mentalement au maximum de la sensation de l’embouchure sur ses lèvres et ne ressentir que les sensations à l’intérieur de son corps. En terme simple : s’intérioriser.
Il n’est pas très facile d’expliquer par écrit la méthode de jeu car la polysémie des mots et la différence de culture de chacun peut amener des différences de compréhension et d’interprétation. Je l’avais déjà signalé en préambule lors de mon premier article. C’est aussi pour cela que Monsieur Robert Pichaureau n’avait pas voulu figer par écrit ce qu’il vivait et expliquait pour éviter toutes dérives et mauvaises interprétations. Il ne voulait pas enfermer son discours dans de "pré-requis savants". Il le voulait non hermétique, accessible à tout un chacun qui veut bien se pencher simplement et humblement sur lui-même.
C’est aussi pour cela que j’insiste sur le fait de rencontrer les gens. D’expliquer oralement ma démarche avec eux (lors de séminaires où journées de rencontre). Et bien entendu pendant les cours aux conservatoires où de nombreux parents pour les plus jeunes, sont intéressés par ce discours qu’ils peuvent d’ailleurs replacer dans les activités et le bien-être de la vie de tous les jours.
Pour poursuivre dans la logique et la cohérence, les prochaines pages concerneront la pédagogie instrumentale qui découle de cette approche basée sur la respiration dite naturelle, l’observation corporelle et la libération de ses sensations au service de la musique. Monsieur Pichaureau tenait sur le fond ces propos: "un artiste sommeille en chacun, sans exception. Ses racines prennent force dans son être profond. Il appartient à chacun de réaliser le travail de mise à nu. C’est par une recherche permanente, dans une confiance en soi tous les jours renforcée que l’artiste se révèle. Et non dans les mesures coercitives, avec son lot de souffrances, avec un esprit arriviste et dominateur. La remise en question assure l’évolution de l’être humain".
Cette pensée humaniste est, je le pense et vis profondément, la base d’une pédagogie qui tient compte d’un respect profond pour l’être humain.
© Alain Faucher 2006