| Introduction | La respiration | La posture | L'émission | Les lèvres | Pédagogie |
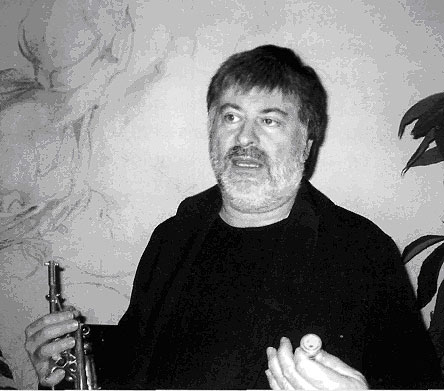
Comme nous l’avons constaté, à la lecture des pages précédentes, notre corps prend une place prépondérante dans le geste musicien.
- Nous sommes, en tant qu’être humain les créateurs du son.
- L’instrument n’est que le propagateur, l’amplificateur.
Il est donc important de nous pencher sur notre entité corporelle, l’étudier sous son aspect fonctionnel et mécanique, sans oublier une partie importante : le cerveau. Celui-ci n’est pas seulement un organe fonctionnel mais aussi le siège d’une pensée, d’une culture, il est le centre de contrôle du conscient, et aussi l’emplacement de l’inconscient ou subconscient.
- Le conscient est le foyer actif de la réflexion qui permet le geste voulu, pensé, préparé, effectué.
- L’inconscient est considéré comme une espèce de mémoire conditionnée et pré-réglée pour fonctionner spontanément en permettant d’accomplir des gestes, des attitudes automatiques, sans réflexion immédiatement préalable.
Bien entendu, notre personnage social, est éduqué culturellement et socialement par la famille, par l’état, par la religion, afin de s’insérer dans un schéma de société, et de s’épanouir dans un cadre présélectionné, contrôlé. Il obéira à des codes, nécessaires à notre vie humaine et citoyenne, c’est souhaitable et rassurant pour l’ensemble de nos concitoyens, mais restrictifs et inhibants lors d’une tentative d’expression artistique et créatrice.
Pour illustrer mes propos, je compare le musicien à l’acteur de théâtre. Dès qu’il pénètre sur scène il doit absolument quitter son enveloppe sociale et l’accrocher à la patère du vestiaire. Il doit oublier son "quant à soi" et retrouver ses origines bestiales édulcorées de tout pré-requis culturel et sociologique afin d’être vrai. Il doit momentanément se désociabiliser pour se recréer et endosser la peau d’un nouveau personnage. Il doit se transcender et utiliser son corps dans son ensemble au service de sa sensibilité. Durant ces instants le corps entier se livre sans recul aucun, avec toute l’énergie centrée sur son geste musicien ou artistique. Sur scène cela s’appelle une prise de risque, mais celle-ci est nécessaire pour espérer côtoyer le Saint Graal.
Pour ce faire, le musicien pratiquant un instrument dit "à vent" doit veiller à la posture générale de son corps. L’objet manufacturé appelé instrument, aussi respectable, beau, historique, etc. qu’il soit, ne doit être considéré qu’en prolongement de l’artiste.
Lorsque l’on joue debout, on doit se camper sur ses deux jambes, légèrement écartée sans les raidir, en recherchant la stabilité et la verticalité en gardant une souplesse au niveau des genoux. Les pieds sont bien plaqués au sol en essayant d’élargir la voûte plantaire. L’idée de se tasser au sol, afin de s’enraciner, est importante. La tête se positionne de manière à nous rapprocher de l’idée du double menton (comme pour les chanteurs lyriques ).
Monsieur Robert Pichaureau, utilisait trois dictons populaires pour étayer la démonstration. "Un homme sensé est quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Un être qui a les reins solides paraît très fort. Un personnage ayant les pieds sur terre ne peut être déstabilisé". Après avoir énuméré ces trois formules, le maître extrayait de ses documents, l’image agrandie d’un singe gorille dont les contours d’ensemble forment un triangle posé sur sa base. "Vous devez êtres un tas" disait-il.
En observant cette image, on ressent un effet de masse stable impossible à ébranler.
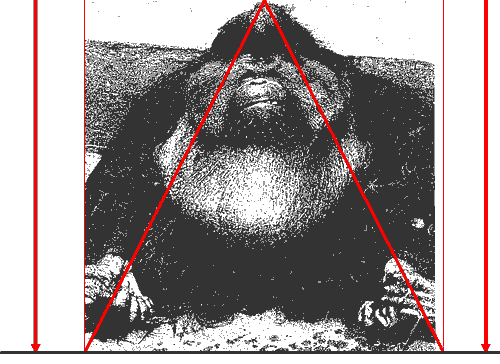
Elle semble puiser ses racines dans le sol.
Nous pouvons aisément comprendre cette posture, car nous l’adoptons en de maintes occasions dans la vie de tous les jours -
par exemple lorsque nous encourageons quelques coureurs cyclistes ou autres sportifs - au moment d’une saine colère à l’instant ou nous poussons un cri - lorsque l’enfant manifeste son envie devant une promesse de cadeau.
Durant ces actes non préparés et non réfléchis nous livrons notre exubérance à la vue de tous, sans retenue aucune. On peut dans cet instant nous qualifier de véhément. Nous nous affirmons du fond de notre être. N’importe qui peut être véhément, cela dépendra de la spontanéité et du naturel du personnage. Je rappelle qu’aucune préparation respiratoire n’est réfléchie pour ces gestes naturels et communs, et qu’ils sont généralement puissants, durables et "vrais". Pour le musicien on peut traduire cela par le mot envie de jouer, donc plaisir. A cette seule condition, il sera perçu de même pour l’auditoire.
L’une des premières difficultés rencontrées, par l’instrumentiste débutant, sera justement d’essayer de retrouver dans un premier temps cette véhémence naturelle et fondamentale. Il ne devra surtout pas l’accompagner volontairement, avec application. Au contraire, il devra se "lâcher". On pourra citer un autre dicton populaire le qualifiant : "il a des tripes" L’image virtuelle du cri sortant du ventre prendra tout son sens.
La posture inverse et préjudiciable, serait de se mettre sur la pointe des pieds, tendre le cou, avancer la tête vers l’instrument, aller à la rencontre de celui-ci. Celle-ci nous inviterait à nous extraire de notre corps et à nous "perdre" dans l’espace sonore du lieu ou nous jouons. L’objet instrument deviendrait l’unique et principal acteur du son. La pratique deviendrait rapidement pénible. La volonté, donc notre conscient, nous inviterait à utiliser un mouvement respiratoire néfaste quant à la procédure, à la qualité sonore, à la décontraction. L’envie de jouer se transformerait vite en obligation de résultats. La communication d’une sensibilité se muerait en exploit technique (peut-être ?).
Pour illustrer le travail sur le corps, Monsieur Robert Pichaureau utilisait une métaphore : "L’artiste est comme un arbre. Celui-ci puise ses racines dans le sol. Si les feuilles périclitent, tu peux toujours, en urgence, essayer de les soigner directement en surface, cela aura peut-être un effet, mais restrictif et ponctuel. Il est préférable de s’occuper des racines. L’effet ne sera peut-être pas immédiat et spectaculaire, il demandera plus de temps, mais il sera durable et interviendra sur l’ensemble du végétal. Les feuilles refléteront la bonne santé de l’arbre".
Dans les pages suivantes, nous parlerons de la gorge, du placement de la langue, de la pince et des lèvres, dont l’importance est minimisée, pour les instrumentistes à embouchure si l’ensemble méthodologique proposé est respecté. Nous verrons également le rapport à l’embouchure, premier élément de contact avec le "tuyau" instrument.
© Alain Faucher 2006