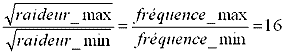
ou raideur maximale = raideur minimale x 256,
Original article in English
L'embouchure de trompette asymétrique
JOHN H. LYNCH
ITG Journal / Février 1996
Depuis de nombreuses années, on essaie
d’améliorer les performances
des embouchures de trompette dans des domaines spécifiques tels que
la facilité du jeu, un plus beau son, et un registre aigu plus facile.
Ces efforts ont été, à ma connaissance, essentiellement
basés
sur une approche par essais et correction d'erreurs, où une amélioration
est déterminée en sollicitant les avis de divers musiciens. Cette
approche de la conception des embouchure a eu un succès limité.
Des progrès ont été accomplis à partir de ces travaux
empiriques, mais seules ont émergé quelques règles générales
pouvant être considérées comme valides.
Deux de ces dernières,
qui sont habituellement considérés comme règles de base
et sont largement acceptés tant par les fabricants d'embouchures que
par les trompettistes, sont :
• Une embouchure ayant une cuvette peu profonde (de faible volume) permet
de jouer plus facilement les notes les plus aiguës mais produit un son
plus métallique sur toute la tessiture de l'instrument. Une embouchure à cuvette
peu profonde est donc souhaitable pour la première propriété et
indésirable pour la seconde.
• Une embouchure ayant une cuvette profonde (de volume élevé)
produit un son plus souhaitable mais est fréquemment difficile à jouer
dans le registre aigu extrême. Une embouchure à cuvette profonde
est donc souhaitable pour la première propriété et indésirable
pour la seconde.
Ces règles ont conduit à deux approches distinctes du jeu de la
trompette. L'approche la plus commune, adoptée par beaucoup d'instrumentistes,
est d'utiliser une embouchure ayant une cuvette de profondeur intermédiaire
comme compromis. L'autre approche consiste à utiliser une embouchure à cuvette
très profonde ou une embouchure à cuvette très peu profonde,
selon le style de jeu choisi par un interprète particulier ; c.-à-d.,
si toutes ses exécutions exigent de jouer dans l’extrême aigu,
il utilisera une embouchure très peu profonde et acceptera d’avoir
un son cuivré dans le registre inférieur. Mais si toutes ses exécutions
n'exigent pas de jouer dans l’extrême aigu, il utilisera une embouchure
profonde afin d'obtenir un son plus beau et plus large. Cela a été et
reste l’approche traditionnelle du choix de l'embouchure, qui laisse beaucoup à désirer.
Dans le cas de l'instrumentiste qui choisit le compromis d’une cuvette
de profondeur moyenne, un tel compromis limite habituellement sa capacité à jouer
l’extrême aigu, et donne également une qualité de
son un peu moins qu'idéale. Et, pour l'instrumentiste qui choisit une
cuvette très peu profonde
ou très profonde, on observe des limitations semblables dans la capacité à jouer
dans l’aigu ou dans la qualité du son. Ces limitations sont un
problème,
car les lèvres d'un interprète doivent s’habituer à un
changement d’embouchure ; cette acclimatation peut nécessiter
seulement quelques jours, mais dans certains cas elle peut prendre des semaines.
Il n'est donc généralement pas possible de passer d'une conception
de cuvette d’embouchure à l'autre pour s’adapter aux besoins
immédiats
de la musique. Ainsi, actuellement les embouchures disponibles n'offrent pas
au trompettiste une solution efficace aux problèmes de tessiture ou
de son.
Jouer de la trompette présente de plus d’autres difficultés
fondamentales. L’une est le grand effort physique
requis de l'instrumentiste pour atteindre sa propre
limite dans l’aigu. Une autre est que même l'embouchure la moins
profonde existante ne peut être jouée de façon fiable
par des élèves trompettistes avancés dans leurs études,
dont certains sont des instrumentistes compétents à d'autres égards,
que jusqu'à un
modeste contre-ut approximativement. On attend aujourd'hui des trompettistes
qu’ils soient capables de jouer de façon courante dans le registre
suraigu jusqu'au contre-sol et parfois jusqu'au « bi-contre-ut ».
Les élèves sont donc souvent découragés quand ils
essayent de jouer dans l’aigu, parce que bon nombre d'entre eux éprouvent
même de la difficulté avec une note aussi basse que le Fa au-dessus
du Do médium ; beaucoup, sinon la plupart, considèrent le bi-contre-ut
comme inaccessible. Ceci a tendance à réfréner leur enthousiasme
; beaucoup abandonnent complètement la trompette pour cette raison.
Pour récapituler l'état actuel des trompettistes en général,
nous pourrions dire qu'ils se classent en approximativement quatre catégories
:
• Une poignée de spécialistes professionnels qui peuvent,
avec un effort physique extrême et des embouchures très peu profondes,
jouer dans le suraigu jusqu’au bi-contre-ut, mais dont le son est dur dans
le registre inférieur.
• Peut-être dix pour cent qui peuvent jouer jusqu’aux environs
du Fa au-dessus du contre-ut, là encore avec un effort extrême et
des embouchures relevées ; ces instrumentistes ont également souvent
un son médiocre.
• Probablement trente pour cent qui peuvent jouer seulement jusqu'aux environs
du contre-ut, également avec un effort extrême.
• Les quelque soixante pour cent restants, la plupart du temps des étudiants,
qui peuvent seulement jouer de façon fiable jusqu'aux environs du sol
en haut de la portée, et avec des difficultés considérables.
Il est clair que la majorité des trompettistes sont limités,
préoccupés,
et/ou gênés d'une certaine manière par les embouchures
actuellement disponibles. Et, en dépit des tentatives des fabricants
d'instruments et d'embouchures pour résoudre ces problèmes, aucun
jusqu'ici n'a réussi. La conception actuelle des embouchures
n’a
pas progressé significativement, concernant ces problèmes
particuliers, au delà des règles de base mentionnées
plus haut. Ce qu’il faut, c’est une nouvelle conception d'embouchure
qui réduise
la difficulté à jouer dans l’aigu pour tous les trompettistes, étudiants
aussi bien que professionnels. Cette nouvelle conception devrait également étendre
le registre aigu des instrumentistes d’un nombre significatif de demi-tons,
idéalement cinq ou plus. Et en même temps, elle devrait imposer
seulement des restrictions minimales à la qualité de son. L'embouchure
décrite ci-après a été conçue pour
satisfaire ces demandes.
L'embouchure asymétrique
Pour mieux comprendre la façon dont l'embouchure asymétrique
satisfait les critères de conception qu’on vient de mentionner,
il est nécessaire de passer en revue le mécanisme de la production
du son avec une embouchure de cuivre, et c’est le but des remarques suivantes.
Une idée fausse répandue au sujet de production du son des cuivres
est que puisque le son est produit par des lèvres vibrantes sous tension,
on peut augmenter la hauteur du son en augmentant la raideur dans le tissu
des lèvres. Nous pouvons voir, pourtant, en utilisant l'analyse physique élémentaire,
qu’une augmentation de raideur seule dans le tissu des lèvres
de l'interprète est insuffisante pour fournir la fréquence de
vibration des lèvres exigée pour jouer sur l'étendue complète
d'un cuivre. L'instrument produit environ quatre octaves utilisables.
Monter la note d'une octave double sa fréquence
; augmenter de quatre octaves la multiplie par seize. Si nous supposons que
tous les paramètres physiques tels que l'élasticité des
lèvres,
la masse etc. sont des constantes, et si seules la raideur et la fréquence
peuvent changer, nous pouvons, en utilisant l'équation élémentaire
donnant la fréquence en fonction de la raideur dans un oscillateur simple,
exprimer le rapport de la raideur maximale à la raideur minimale comme
:
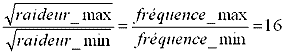
ou raideur maximale = raideur minimale x 256,
de sorte que même si la raideur minimale était seulement de quelques
onces, la raideur la plus élevée serait de plus de trente livres
et romprait sûrement le tissu fragile des lèvres. Ainsi, nous
pouvons sans risque conclure que la tension des lèvres seule ne peut
pas produire une gamme de quatre octaves. Quel est alors, pourrions-nous demander,
le mécanisme supplémentaire qui permet de jouer sur quatre octaves
?
Le fait est que bien que les fréquences les plus élevées
dépendent dans une certaine mesure de la tension accrue du tissu des
lèvres, le mécanisme causal principal qui est en jeu ici est
une réduction de la masse vibrante efficace de la lèvre supérieure.
Cette réduction est provoquée par la lèvre inférieure
de la façon suivante. Quand l'interprète souhaite monter la note,
- qu’il y arrive ou non – il presse la lèvre inférieure
vers le haut contre la lèvre supérieure. Cette compression ascendante
a pour effet d'immobiliser partiellement la lèvre supérieure
et de réduire de ce fait sa masse vibrante efficace. Quand la masse
de l’oscillateur est réduite, la fréquence de la vibration
augmente, et la note monte.
On constate cet effet avec d'autres oscillateurs, tels qu'une corde de violon.
Pour monter la note, un violoniste raccourcit la corde en l’appuyant
plus bas contre la touche avec son doigt. La seule partie qui est alors libre
de vibrer est comprise entre son doigt et le chevalet ; cette partie a une
masse plus faible que la corde complète sans le doigt pour la raccourcir.
Ainsi, la corde plus légère et plus courte a une fréquence
de vibration plus élevée. La tension de la corde est essentiellement
la même, avec ou sans raccourcissement. Les deux lèvres d'un
joueur de cuivres fonctionnent ensemble comme la corde du violon et le doigt
du violoniste. Jouer sur l'étendue complète de la trompette en
comptant sur la seule variation de tension des lèvres serait comme jouer
du violon avec une seule corde à vide, changeant constamment la hauteur
en utilisant uniquement la cheville d'accord - clairement une impossibilité !
Quand nous changeons la tension des lèvres, c’est comme changer
de corde sur un violon. C'est un changement brut (il y a quatre cordes), et
plusieurs hauteurs de son sont disponibles avec une tension donnée,
exactement comme plusieurs hauteurs de son sont disponibles avec une corde.
Quand nous montons la lèvre inférieure en jouant de la trompette,
c’est
comme appuyer le doigt sur la corde en jouant du violon. Cela produit un changement
de tension et un changement de masse, mais le changement de masse est clairement
le plus important. Il est nécessaire de se rappeler dans toute cette
discussion, que si trop de pression est appliquée aux lèvres
par l'intermédiaire
de l'embouchure, on en perd le contrôle et les aigus deviennent inaccessibles
; aussi nous devons nous efforcer de "garder de la chair" c.-à-d.,
garder une épaisseur suffisante de lèvres entre l'embouchure
et les dents. Toute "pression" requise doit être pensée
comme verticale entre les lèvres, plutôt que horizontale (embouchure
contre les lèvres).
Des études expérimentales (réf. Henderson) ont vérifié que
les lèvres supérieure et inférieure d'un trompettiste
fonctionnent de manières distinctes et différentes. Dans ces études,
la fonction de la lèvre supérieure s'est avérée
de vibrer d’avant en arrière (pour ouvrir et fermer le passage)
afin d'admettre des bouffées d’air successives dans l'embouchure,
créant de ce fait les compressions et les raréfactions d'air
alternatives exigées pour la production du son. La fonction principale
de la lèvre inférieure s'est avérée de se serrer
vers le haut contre la lèvre supérieure afin de commander la
fréquence de vibration de la lèvre supérieure en réduisant, à des
degrés variables, sa masse vibrante efficace. Après avoir discuté la
théorie du fonctionnement de l’embouchure, je voudrais maintenant
examiner la géométrie de l’embouchure des cuivres telle
qu'elle se relie à la théorie qui a été développée à partir
d’études expérimentales systématiques, avec des
prototypes expérimentaux, pour arriver au concept d'embouchure asymétrique
que nous préconisons.
Si nous examinons les embouchures de cuivres actuellement disponibles, nous
constatons sans exception qu'elles ont une symétrie radiale. Ceci suggère
que les fabricants considèrent actuellement que, bien que les lèvres
supérieure et inférieure aient apparemment une structure physique
différente, et bien qu'elles aient clairement des fonctions différentes,
une embouchure puisse fonctionner correctement sans en tenir compte ; c.-à-d.
que toutes les embouchures disponibles dans le commerce et à symétrie
radiale ignorent les différences physiques ou fonctionnelles entre les
lèvres supérieure et inférieure. Nous notons, en revanche,
que ce n'est pas du tout le cas pour les instruments à anche,
tels que la clarinette ou le saxophone. Avec ces instruments, les embouchures
sont nettement asymétriques et sont conçues spécifiquement
pour s’adapter à des différences physiques et fonctionnelles
entre les lèvres supérieure et inférieure. Une autre explication
possible pour la symétrie des embouchures de cuivres est que les fabricants
ne sont peut-être pas conscients du mode de fonctionnement décrit ci-dessus,
ou bien n’y attachent pas d’importance. Mais l'explication la plus
probable pourrait être que les embouchures ont été toujours
faites de cette façon. Historiquement, les premiers "instruments" étaient,
selon toute probabilité, des cornes d’animaux avec le petit bout
coupé. Depuis lors, la symétrie normale de la corne animale a
régné. En outre, les embouchures sont tournées sur des
tours, et ce mode de fabrication a probablement contribué à perpétuer
la notion de symétrie comme étant exigée ou même
idéale. En tout cas, la symétrie radiale n'a été jamais
remise en cause jusqu'ici, pour tenir compte des fonctions différentes
des lèvres expliquées ci-dessus.
Conjecturant qu'une cuvette d'embouchure pourrait probablement répondre
différemment aux lèvres supérieure et inférieure
aussi bien qu'à la profondeur de cuvette, on a construit des prototypes
et réalisé des expériences en utilisant un modèle
de « régression factorielle fractionnaire orthogonale composite » (réf.
Davies et Lynch) dans lequel la courbure de la moitié supérieure
de la cuvette, la courbure de la moitié inférieure de la cuvette
et la profondeur de cuvette ont été traitées en tant que
variables indépendantes. L'optimisation des performances de réponse
résultant de l'équation a montré que l'embouchure idéale
avait une moitié inférieure convexe et supérieure concave.
Ces expériences, avec plusieurs prototypes réalisés ensuite
pour explorer et développer cette configuration, ont mené à l'explication
théorique suivante pour les résultats expérimentaux.
Supposons qu'à une fréquence quelconque, la lèvre inférieure
d'un trompettiste exerce une force ascendante suffisante pour assurer qu’une
masse efficace adéquate de lèvre supérieure vibrera pour
produire cette fréquence. Quand le trompettiste essaye des fréquences
de plus en plus élevées, il finit par atteindre la poussée
ascendante maximale qu'il est capable d'exercer et joue à ce moment
la note la plus aiguë qu'il est capable de produire. Considérons
maintenant la lèvre inférieure plus en détail.
La partie de la lèvre inférieure qui se trouve en contact avec
le bord de l'embouchure est bloquée sur sa face interne de façon
rigide par les dents du bas. Elle est également bloquée sur les
côtés et en bas par le bord de l'embouchure. Mais elle n'est pas
bloquée sur sa surface frontale, qui fait face à la cuvette d'embouchure,
ni sur sa surface supérieure, qui est pressée vers le haut contre
la lèvre supérieure par le trompettiste. Cette poussée
ascendante est provoquée par la contraction des muscles des lèvres,
particulièrement les muscles qui commandent la lèvre inférieure.
Le tissu des lèvres est alors renflé vers le haut et vers l'avant,
les seules directions dans lesquelles il n'est pas bloqué. La composante
ascendante du renflement produit l'immobilisation exigée de la lèvre
supérieure, et le composante vers l'avant fait pénétrer
la lèvre inférieure dans l'embouchure. Ce bombement vers l'avant
n’apporte rien d'utile ou significatif, excepté de réduire
légèrement le volume de cuvette, ce qui produit un effet léger,
voire négligeable, sur les qualités de justesse et de timbre.
Cela étant rappelé, nous considérons maintenant une géométrie
alternative pour la moitié inférieure de la cuvette.
Si la demi cuvette inférieure en face de la lèvre inférieure
est rendue suffisamment convexe (voir la photographie), la partie de la lèvre
qui s’enfonce dans la cuvette tendra maintenant à être repoussée
en arrière vers l'instrumentiste au contact de cette convexité.
Alors la lèvre, étant un récipient élastique (tissu
des lèvres) rempli de fluide essentiellement incompressible (sang),
se comportera comme un ballon rempli d'eau et s’adaptera à cette
compression additionnelle en enflant encore plus dans la seule direction non
bloquée restante, à savoir vers la lèvre supérieure.
Cette poussée ascendante additionnelle aura alors pour conséquence
une immobilisation additionnelle de la lèvre supérieure et donc
dans une augmentation de la fréquence de vibration de la lèvre
supérieure; c.-à-d., un son plus aigu. Les prototypes ont permis
une augmentation typique de la tessiture due à ce mécanisme allant
jusqu’à sept demi-tons. En outre, en raison de la forme globalement
convexe du bord principal de cette demi cuvette inférieure, l'action
de ce mécanisme est progressif et augmente de façon continue
avec la hauteur de son ; c.-à-d. qu’elle a un effet faible à nul
dans les registres grave et médium où l'intrusion de la lèvre
est négligeable, et un effet graduellement croissant avec la fréquence
quand la pression d’air devient plus importante et que la pression accrue
de l'embouchure contre les lèvres associée à la contraction
musculaire plus forte cause normalement une plus grande intrusion de la lèvre
inférieure. Ainsi, la convexité de la partie basse non seulement étend
la tessiture du trompettiste dans l’aigu mais rend plus aisé le
jeu dans ce registre.
La convexité de surface de la demi cuvette inférieure, par elle-même,
réduira le volume global normal de la cuvette. Sans compenser cette
réduction, le son tendrait vers le caractère cuivré des
embouchures relevées à cuvette conventionnelle. Cette réduction
de volume de cuvette peut être compensée, cependant, en agrandissant
la partie concave supérieure de la cuvette. Par exemple, si nous savons
qu'un volume particulier de cuvette symétrique produit une qualité particulièrement
souhaitable de son, au lieu de réduire ce volume en rendant la cuvette
moins profonde afin d'obtenir plus de possibilités dans l’aigu
(comme on le fait actuellement, dégradant le son de ce fait), nous redistribuons
dans l'espace ce volume particulier de cuvette en rendant le bas convexe et
la surface supérieure suffisamment concave. Ceci se conforme à l'idéal
dérivé des expériences ayant la demi cuvette inférieure
convexe et supérieure concave. On a montré que c’est le
volume total de cuvette et de queue d'embouchure, plutôt que la forme
particulière d'une cuvette, qui tend à déterminer la qualité de
son et les caractéristiques de jeu pour un instrumentiste donné (réf.
Benade). Ainsi, dans le cas présent, la cuvette asymétrique aura
essentiellement le même volume de cuvette que la cuvette symétrique,
et la qualité de son demeurera intacte. Mais elle offrira une plus
grande étendue et une plus grande facilité globale du jeu dans
l’aigu par rapport à l'embouchure à cuvette symétrique.
Il convient de noter que toute forme symétrique de blocage de la lèvre
inférieure limiterait également la lèvre supérieure
et empêcherait sa vibration. Et, même si un tel blocage était
de largeur relativement petite, il réduirait également l'envergure
de la cuvette pour la lèvre supérieure. Mais la pleine envergure
de la cuvette est exigée pour la lèvre supérieure sinon
la masse vibrante serait trop restreinte et la propreté d’attaque
compromise. Les calculs et les prototypes ont prouvé que même
avec un repositionnement vertical de l'embouchure, la différence serait
telle que si le jeu était amélioré par le blocage de la
lèvre inférieure, il serait altéré par le blocage
simultané de la lèvre supérieure. Ainsi, l'asymétrie
est exigée. Il faut également noter que les instrumentistes utilisant
un placement vertical incorrect de l'embouchure (autre que le 1/3 sur la lèvre
supérieure et 2/3 sur la lèvre inférieure généralement
admis) ne pourront pas utiliser l'embouchure asymétrique avec succès.
Les instrumentistes qui placent l'embouchure "moitié sur chaque
lèvre" par exemple ou plus sur le haut que sur le bas ressentiront
la convexité comme un obstacle au jet d'air. La plupart des trompettistes,
toutefois, utilisent le placement de l’embouchure « 2/3 en bas,
1/3 en haut », qui est recommandé depuis plus d’un siècle
(voir, par exemple, la méthode Arban) comme plus avantageux pour jouer
dans l’aigu. Il est clair que c'est pour avoir moins de lèvre
supérieure à immobiliser, mais ceci n’a été reconnu
que par l’expérience avant les 50 dernières années.
Les autres positions handicapent vraiment le trompettiste de façon inutile.
 Résumé.
Résumé.
La conception asymétrique de la cuvette peut ajouter jusqu'à une
demi-octave d’étendue dans l’aigu et faciliter plus généralement
l’émission de toutes les notes dans ce registre, et ceci sans
perte de qualité de son. L'embouchure à cuvette asymétrique
discutée ci-dessus est donc sensiblement et indéniablement supérieure
aux embouchures à symétrie radiale. En outre, la théorie
sous-jacente à ce concept est validée par des prototypes et des
données expérimentales systématiquement obtenues et ne
repose pas sur des essais empiriques.
L'embouchure asymétrique s’utilise
exactement de la même
façon qu’une embouchure symétrique à une petite
mais importante exception près ; l'asymétrique doit être
insérée dans la trompette avec la partie convexe de la surface
de cuvette vers le bas, afin d'être sensiblement plus proche de la lèvre
inférieure que de la lèvre supérieure. Une fois installée
avec cette orientation, aucune autre considération spéciale n'est
exigée puisque l'embouchure ne tourne pas dans l'instrument quand
on joue. Les essais ont prouvé qu’on peut tolérer au moins
dix degrés de rotation, dans un sens ou dans l’autre, sans altérer
sensiblement l'efficacité de l'embouchure asymétrique. En outre,
l'orientation des coulisses de la trompette, des pistons, et de toute autre
structure vis-à-vis de l'orientation axiale de l'embouchure fournit à l'instrumentiste
une confirmation visuelle instantanée de l'orientation axiale de l'embouchure
en jouant. Cette orientation demeurera à peu près constante,
parce que la position de la main de l'interprète doit rester essentiellement
la même en jouant pour assurer une bonne manipulation des pistons.
Références :
Henderson, H.W. An Experimental Study of Trumpet Embouchure. J.A.S.A., Vol.
13, pp. 58-64, July 1942.
Davies, O.L. The Design and Analysis of Industrial Experiments. Hafner Publishing
Co., 1956.
Lynch, J.H. A Systematic Approach to Model Development by Comparison of Experimental
and Analytical Regression Coefficients. NASATM-X1797, May 1969.
Benade, A.H. Fundamentals of Musical Acoustics. Oxford University Press, pp.
414-418, 1976.
Traduit en janvier 2004 par Joël Eymard pour le site web "Tout sur la trompette"