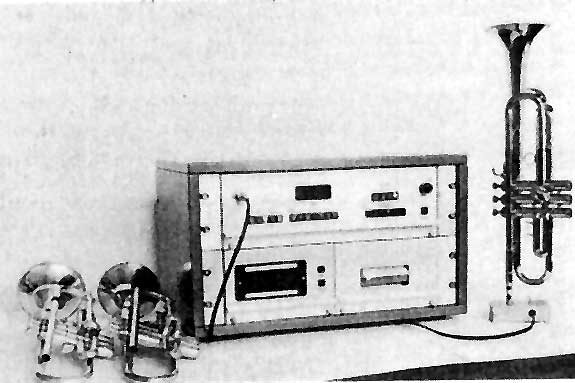
Fig. 1 L'appareil conçu pour localiser automatiquement et
détecter les résonances d'un instrument à vent. L'affichage numérique
indique la justesse et l'amplitude des résonances
.
Une approche systématique de la correction de justesse
des instruments à vent
Richard A. Smith
Boosey and Hawkes Ltd, Edgware, Middlesex, UK et Department
of Physics, Southampton University
Geoffrey J. Daniell
Department of Physics, Southampton University, Southampton
SO9 5NH, UK
On étudie l'effet de perturbations du diamètre de perce sur la justesse des instruments à vent. A partir de mesures de la perce et de l'amplitude des ondes stationnaires, on calcule une forme modifiée de perce pour apporter n'importe quelle correction souhaitée à la justesse. |
Les instruments de musique ont évolué au cours
des siècles en grande partie par essais et correction d’erreurs.
Malgré les recherches scientifiques, de nombreux facteurs
indéterminés
affectent de façon critique le jeu des instruments, et on doit encore
recourir à des méthodes
empiriques de conception. Quelques caractéristiques,
cependant, sont facilement susceptibles d’un traitement quantitatif,
et nous présentons ici les résultats de quelques calculs et expériences
sur l’amélioration de la justesse et du timbre de la trompette.
Tous les cuivres ont des insuffisances acoustiques et mécaniques que
la plupart des instrumentistes compensent automatiquement1.
Pour l'auditeur moyen, un instrument peut jouer parfaitement juste mais ceci
résulte en grande partie de la compétence de l'instrumentiste
qui peut être capable de corriger une note de ± ½ ton avec
les lèvres, habituellement aux dépens de la qualité du
son. De même, la justesse de jeu des instrumentistes inexpérimentés
tend à être affectée davantage par les défauts de
leurs instruments.
La fréquence d'une note produite par une trompette est déterminée
par une interaction complexe entre la colonne d'air vibrant dans l'instrument
et les lèvres de l'instrumentiste. Elle est également affectée
par rétroaction acoustique aux oreilles de l'instrumentiste, et on observe
des différences de plus de 10 cents (1 cent = 0,01 demi-ton tempéré)
quand différents instrumentistes utilisent le même
instrument. La fréquence jouée est cependant toujours très
proche d'une fréquence de résonance de la colonne d'air de la
trompette.
Plusieurs
auteurs2-7 ont reconnu la nécessité d'éliminer
d'abord la contribution de l'instrumentiste individuel à la justesse,
mais aucune méthode satisfaisante
d'excitation artificielle n'a été encore décrite. Nous
avons utilisé une variante de la méthode décrite à l'origine par
Webster3 pour mesurer les
fréquences de résonance de la colonne d'air dans la trompette.
L'appareil (fig. 1) fonctionne sur la gamme de fréquence Ut2 (65
hertz) à Si7 (3951 hertz) (Ut4 =
Ut médian) et inclut un dispositif de repérage et de calage automatique
sur l'emplacement des pics de résonance. Il offre
un affichage numérique et un enregistrement imprimé de l'amplitude
et de la justesse de chaque résonance (en cents) par rapport à la
gamme tempérée.
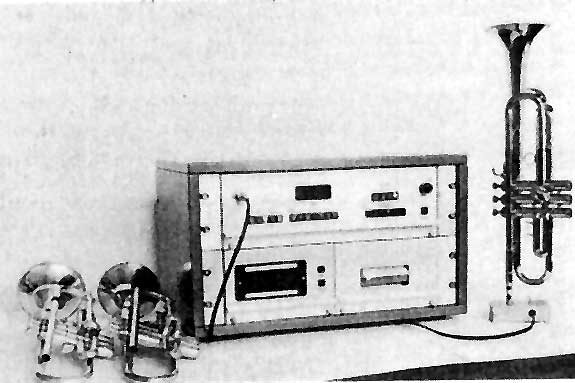
On a constaté que la fréquence de chaque résonance
d'un instrument correspondait étroitement à la moyenne des fréquences
produites pour cette note par un certain nombre d'instrumentistes, de sorte
que les observations faites avec cet appareil peuvent donc être utilisées
comme base de la mesure quantitative de la justesse de l'instrument.
Résonances et couleur de son
Les fréquences de résonance sont principalement déterminées
par la forme de la perce de la trompette, et l'évolution a produit une
forme de perce produisant des résonances assez proches des notes correspondantes
de la gamme tempérée. Malheureusement la justesse n'est pas le
seul critère à considérer quand on fixe les résonances
comme le montre l'exemple suivant.
La figure 2 montre les 10 premières résonances du tube avec leur
correspondance en fréquences de la gamme tempérée
.
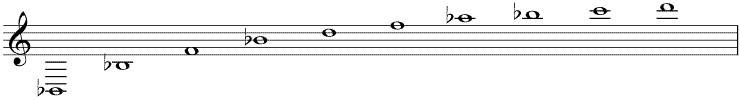 |
|||||||||||
| Résonance | 1* |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7* |
8 |
9 |
10 |
|
| Note | Sib2 |
Sib3 |
Fa4 |
Sib4 |
Ré5 |
Fa5 |
Lab5 |
Sib5 |
Ut6 |
Ré6 |
|
| Fréquence (Hz) | 116,54 |
233,08 |
349,23 |
466,16 |
587,33 |
698,46 |
830,61 |
932,33 |
1046,5 |
1174,7 |
|
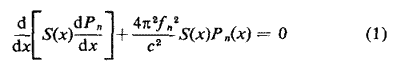
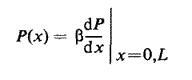
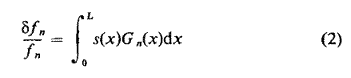
où
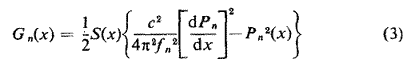
En la dérivant, il faut mettre dS à zéro aux deux extrémités de l'instrument de sorte que les conditions aux limites soient inchangées. Les valeurs de Pn(x) utilisées ci-dessus sont supposées normalisées, de sorte que
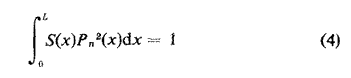
Ceci implique que la dimension de P soit L-3/2, et non celle d'une pression. Ont peut tirer une expression alternative de Gn(x) en partant de l'équation (1)
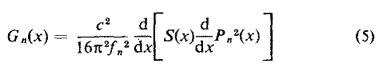
Nous voulons prescrire dfn et
calculer dS(x).
Il est clair que la solution n'est pas unique, et nous chercherons les variations
les plus "lissées" de la perce qui produisent les décalages de fréquences requis.
Il n'est pas pratique de faire des modifications sur l'ensemble de l'instrument,
à cause des pistons et de la coulisse d'accord, et nous les restreindrons à
la zone allant de x
= 0 à x
= l.
Pour éviter toute discontinuité de la perce, il faut dS(0)
= 0 and dS(l) = 0.
Une mesure convenable du lissage est la moyenne quadratique de la dérivée
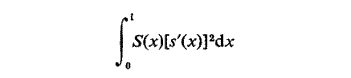
que nous allons minimiser, sous la contrainte que s(x) produise les décalages de fréquence requis en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange, ce qui conduit à minimiser
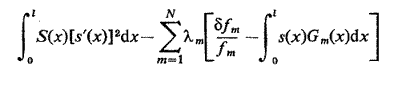
L'équation d'Euler de ce problême est
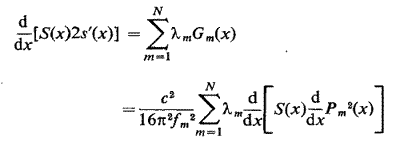
Après deux intégrations, nous obtenons
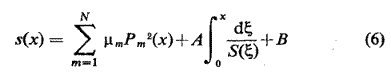
A et B sont des constantes d'intégration arbitraires et
peuvent être choisies pour avoir dS(0)
= 0 et dS(l) =
0,
et mm est
un multiple de lm.
En substituant dans (2) on obtient N équations linéaires qui, avec
les conditions surdS,
determinent les N+2 constantes mm , A,
B. L'équation
(6) donne alors les variations de perce requises.
Le lecteur peut se demander pourquoi nous avons utilisé la perturbation
la plus "lissée" plutôt que la plus petite.
Si nous définissons
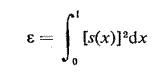
et cherchons la fonction s(x) qui le minimise et produit les décalages de fréquences requis, nous obtenons
![]()
Cette fonction ne peut toutefois être utilisée pour résoudre notre problème
puisqu'elle n'assure pas que dS(0)
= 0 et dS(l)
= 0.
Les fonctions propres des ondes stationnaires
On a besoin des fonctions Pn(x) pour effectuer
les calculs du paragraphe précédent. Bien qu'il
soit possible, en principe, de les calculer à partir de
la section de la trompette, il est assurément plus facile
de les mesurer.
Dans une onde stationnaire, quand l'amortissement est très faible,
les oscillations ont la même phase en tous points entre des
nœuds adjacents, et la phase change de p en
franchissant chaque nœud. Ce résultat n'est pas exact si on tient
compte de l'amortissement, mais comme nous avons négligé l'amortissement,
même dans l'équation (1), il n'y a aucun intérêt observer
la phase des oscillations de pression, et nous supposerons que la phase est
0 ou p.
La fonction Pn(x) est donc donnée
par l'amplitude de pression observée entre les paires alternatives
de nœuds moins la pression observée dans les intervalles.
On a également besoin de la dérivée dPn/dx.
En raison des dangers bien connus de la différentiation numérique
nous l'obtenons en intégrant l'équation (1) ce qui donne
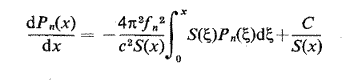
La valeur de la constante d'intégration C est obtenue en intégrant de nouveau, introduisant ainsi une autre constante, et on obtient les deux constantes en appliquant les équations à deux valeurs particulières de x.
Influence de la longueur de tube où sont
appliquées les modifications
On peut tirer un résulat intéressant sur la moyenne quadratique des perturbations,
qui peut être évaluée avec l'équation (7). Elle peut être dérivée par rapport
à l,
sachant que les valeurs de m dependent de l.
Les dérivées de m peuvent être éliminées
en dérivant l'équation (2) et on obtient le résultat remarquable

Il en résulte que ![]() n'est
jamais positif, et la moyenne quadratique des modifications requises diminue
toujours quand on répartit les modifications de perce sur une plus grande longueur
de tube.
n'est
jamais positif, et la moyenne quadratique des modifications requises diminue
toujours quand on répartit les modifications de perce sur une plus grande longueur
de tube.
Résultats asymptotiques
Les valeurs propres de rang élevé d'une équation de Sturm-Liouville ont une
distribution asymptotique simple9.
Quand n est grand, fn ~ nc/2L et
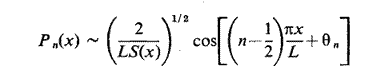
où qn dépend des conditions aux limites. Les instruments de musique tels que la trompette ont évolué vers une forme telle que les fréquences des résonances sont presque uniformément espacées. En d'autres termes, la formule fn ~ nc/2L, qui peut être prouvée pour n suffisamment grand, est en fait presque exacte pour tout n. Ceci suggère que les fonctions propres asymptotiques associées, Pn(x), pourraient être de bonnes approximations pour tout n. Ceci éviterait la mesure difficile de Pn(x). Si les conditions aux limites de la trompette sont approximativement
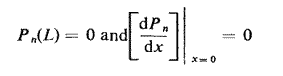
on peut montrer que
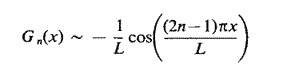
Les intégrales impliquées dans les calculs
peuvent être maintenant évaluées analytiquement.
Nous avons testé ces calculs en imposant des valeurs à fn,
en calculant la forme de perce requise à partir de l'expression asymptotique
de Gn(x) puis en calculant les décalages
de fréquence exacts (équation
2) que cette forme de perce produirait, en utilisant les vraies valeurs mesurées
de Gn(x).
Les variations de perce se sont avérées être dans le bon sens mais avec
des erreurs importantes. Les résultats asymptotiques peuvent néanmoins être
utilisées avec profit si (a) on a besoin d'une approximation rapide (la mesure
des Pn(x) prend du temps),
ou si (b) un partiel de rang très élevé nécessite une correction, là où il
est impossible de mesurer la résonance.
Vérification de la théorie
La trompette a été excitée par l'appareil automatique
décrit
dans la première section et la pression acoustique a été mesurée
de deux manières : en utilisant des tubes de sonde insérés
radialement dans des trous pratiqués tous les centimètres sur
la longueur de l'instrument, ou en utilisant une longue sonde flexible enfilée
dans l'instrument. Il y a peu d'écart entre les résultats
de l'une ou l'autre méthode qui sont présentés
avec les fonctions calculées Gn(x) à
la figure 3.
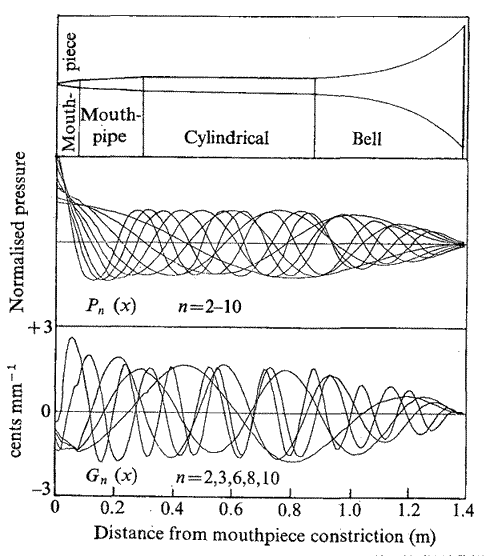
Fig. 3 Forme de perce réelle d'une trompette
(schéma sans échelle) avec Pn(x) et Gn(x) pour
quelques modes choisis.
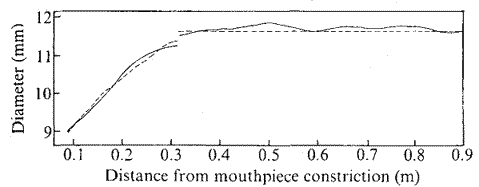
Fig. 4 La forme de perce d'une trompette
(parties conique et cylindrique)
avant et après modification :____ perce
modifiée ; ----- perce originale
.
( NdT : distance mesurée à partir du grain de l'embouchure)
Dans un précédent paragraphe, on a évoqué la difficulté du choix de la justesse optimale d'un instrument. Pour vérifier nos idées, nous avons choisi d'imposer arbitrairement les modifications suivantes : pour les cinquième et dixième résonance, un changement de +5 cents, pour la sixième résonance un changement de -5 cents, et les autres résonances inchangées. De même, la longueur sur laquelle portent les modifications de perce a été arbitrairement limitée à 0,9 m à partir de l'embouchure de l'instrument.
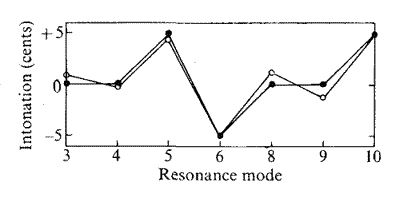
Fig. 5 Justesse relative de sept modes
de résonance.
• : changement de hauteur exigé ; o : changement obtenu par la modification
de perce.
Cette perce correspond aux notes "à vide" de l'instrument et des longueurs de tube additionnelles sont insérées par les pistons pour produire une gamme chromatique. En conséquence l'effet de notre modification est susceptible d'être moins précis quand on ajoute des longueurs de tube ; la méthode des perturbations pourrait être appliquée aux tubes additionnels des pistons pour corriger les notes qui les utilisent. L'équation (8) implique qu'en raison de la longueur relativement courte de la tuyauterie des pistons, seules de petites corrections de justesse pourraient être faites de cette façon sans nécessiter des variations de diamètre importantes et inacceptables.
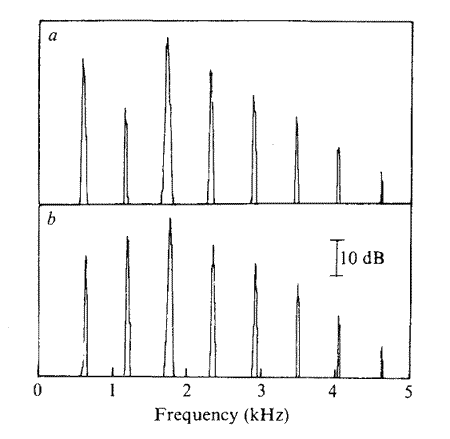
Fig. 6 Spectre de la note Ré5 (587.33
Hz) jouée par un musicien professionnel
(a) avant et (b) après modification.
Les deux notes ont été jouées mezzoforte
dans une chambre sourde
avec le microphone à 1 m dans l'axe de l'instrument
.
Le graphique de la nouvelle forme de perce (fig. 4) montre
un changement maximum de diamètre < 0,2 millimètre. Ceci
peut être comparé à un maximum de 0,14 millimètre
pour la plus petite perturbation en moyenne quadratique citée précédemment.
La nouvelle forme a été reproduite avec une résine renforcé par
fibres de verre et ses résonances ont été mesurées à l'aide
de l'appareil automatique. Il y a une correspondance étroite entre
les justesses requise et mesurée
(fig. 5) ; les petites erreurs résultent principalement de la difficulté à produire
une nouvelle perce avec une précision meilleure que 0,02 millimètre.
On peut déduire de l'analyse qualitative des effets de
changements de diamètre
aux nœuds et aux ventres de vibration que certains décalages
de fréquence
imposés peuvent exiger des changements contradictoires de diamètre.
Le résultat
dans ces cas est que des augmentations et des diminutions très importantes
de diamètre sont exigées sur des distances courtes.
Elles seraient inacceptables sur un instrument de musique et rendraient également
invalide notre théorie des perturbations au premier ordre.
Notre procédé d'optimisation
assure que des changements importants de diamètre ne sont pas appliqués
inutilement.
Pour la comparaison on a effectué un autre calcul qui suppose une forme
de perce non-optimum donnée par superposition d'ondes sinusoïdales.
Le changement maximum de diamètre exigé ici était
de 3 millimètres.
Corriger une trompette défectueuse
Bien que la théorie précédente ne convienne pas idéalement
à la conception acoustique complète d'un nouvel instrument,
la meilleure application de ce travail est l'amélioration des différentes
notes d'instruments prototypes ou de production. Un tel instrument s'est
avéré avoir une deuxième harmonique faible en jouant
le Ré5 (587,33 Hertz) (Fig. 6a). Comme on
l'a déjà mentionné,
cette harmonique mobilise la dixième résonance pour se renforcer,
qui s'est avérée basse par rapport à la cinquième.
La dixième résonance n'est pas normalement jouée en tant
que fondamental et par conséquent on peut la modifier pour
améliorer le timbre. En utilisant
notre nouvelle technique nous avons pu faire monter cette dixième
résonance
de dix cents pour améliorer la réponse
(Fig. 6b).
Ce travail a été soutenu en partie par le SRC et Boosey &
Hawkes Ltd. Nous remercions le Dr. D. M. A. Mercer pour ses encouragements
et sommes reconnaissants également
de l'aide de M. W. Tompkins et du trompettiste Michael Laird.
Reçu le 13 mai ; accepté le 21 juillet 1976 et publié dans Nature, vol. 262 du 26 août 1976, pp. 761-765.
1 Smith, R. A., thèse de doctorat, Univ.
Southampton (1974) .
2 Martin, D. W., thèse, Univ. Illinois (1941).
3 Webster, J. C, J. acoust. Soc. Am., 19, 902-906 (1947).
4 Igarashi, J., et Koyasu, M., J. acoust. Soc. Am., 25, 122-128 (1953).
5
Hunt, F. V., J. acoust. Soc. Am., 10, 216-227 (1939).
6 Backus, J., et Hundley, T. C, J. acoust. Soc. Am., 49, 509-519 (1970).
7 Benade, A. H., et Jansson, E. V., Technical Report (Speech Transmission
Laboratory, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1973).
8 Morse, P. M., Vibration and Sound, 2nd ed., 269 (McGraw-Hill, New York,
1948).
9 Morse, P. M., et Feshbach, H., Methods of Theoretical Physics, par. 6.3
(McGraw-Hill, New York, 1953)
Traduit en janvier 2004 par Joël Eymard pour le site web "Tout
sur la trompette"