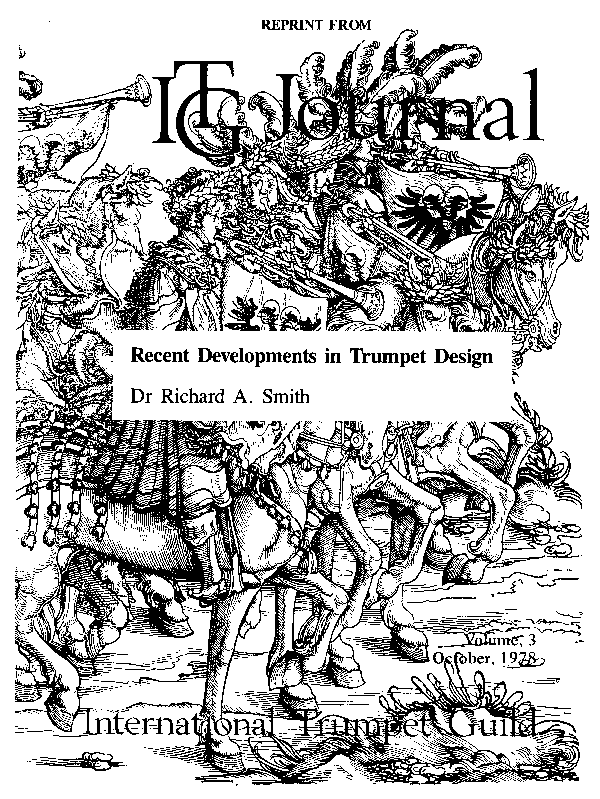
Version
originale en anglais
Développements récents
dans la conception des trompettes
Dr. Richard A. Smith
Article publié dans le ITG Journal d'octobre 1978
A en juger par la quantité et la qualité de
l'information technique diffusée par les fabricants de trompettes,
on peut aisément supposer
que leurs instruments sont encore développés par une forme
de sélection
naturelle où un instrument construit aujourd'hui est conçu
d’après
ce qui est jugé être l'instrument le plus réussi construit
hier, dans l'espoir que les meilleures qualités du premier instrument
seront reproduites dans sa descendance.
Les catalogues des fabricants ne sont pas vraiment utiles avec leur description
qualitative ; ils abondent de jargon pseudo-scientifique, reflétant
vraisemblablement l'idée que se font les fabricants des besoins du
marché.
Cependant, il est encourageant que quelques fabricants, Renold Schilke et
Boosey et Hawkes, par exemple, donnent certaines indications sur leurs
méthodes
de conception dans leurs publications dans l'espoir que l'information essentielle
de conception ne disparaisse pas avec l'habile artisan.
Schilke et Boosey et Hawkes (Smith, R.A. et Daniell, G.J., Nature 262, p.
761-765, 1976.) ont développé des techniques permettant d’améliorer
la justesse d'une trompette. Tous deux se sont basés sur le travail
original attribué à Mahillon (Belgique) et à Blaikley
(Angleterre) vers la fin du 19ème siècle, qui ont constaté que
de petits changements de section de perce près d'un noeud de pression
(zéro)
ou d’un ventre (maximum) de l’onde stationnaire changeait la
fréquence
de résonance. (Une réduction de la section du tube à un
ventre de pression produit une augmentation de la fréquence de résonance
correspondante et une augmentation de section diminue la fréquence. À un
noeud de pression les effets sont inversés.)
Pour pouvoir faire ces corrections il est nécessaire de connaître
la position précise sur la longueur de l'instrument des noeuds et
des ventres pour chaque note (et ses harmoniques). Des mesures internes de
pression exigent de jouer une note sans interruption, aussi divers types
de MIPS autorégulés
ou générateurs de sons ont été conçus.
Ma conception particulière est présentée à la figure
1 et a l'avantage supplémentaire d’une boucle de rétroaction
automatique, de sorte qu'elle se comporte comme des lèvres d'un instrumentiste.
En d'autres termes, si la longueur de tube est changée en déplaçant
la coulisse d'accord ou en enfonçant un piston, les lèvres
suivront automatiquement la résonance de l'instrument. Un ensemble
de résonances
est l'empreinte digitale d'un instrument à vent ; il détermine
ses qualités
musicales telles que la justesse et la qualité de son et sera
différent
pour chaque instrument, même ceux construit en un même groupe.
Par conséquent, il n'est pas étonnant que les instrumentistes
les plus avertis puissent trouver des différences entre des instruments
prétendument
identiques.
Quand un instrumentiste joue une note simple, il produit un son contenant
une série d'harmoniques dont les fréquences sont exactement dans des rapports entiers. Malheureusement, ceci est souvent compris comme
si les résonances
de l'instrument (ou les notes « à vide », incorrectement
appelées
série harmonique) étaient pareillement réparties.
Il ne peut en être ainsi, car a) leur irrégularité est
la cause des petites mais importantes différences entre instruments,
comme on vient de le voir, et b) les acousticiens peuvent les déplacer
pour apporter des améliorations. Il faudrait ajouter qu'un compromis
doit être
trouvé et qu’aucun arrangement des résonances de l'instrument
ne produira l'instrument parfait.
L’appareil automatique a aidé à développer
le meilleur compromis pour les positions des résonances qui améliorent
la justesse et la qualité de son. Au départ, on a permis à l'appareil
de localiser et exciter la deuxième résonance (le
Sib3 grave)
tandis qu'un microphone-sonde était
enfilé dans la perce. La réponse de pression mesurée
par le microphone a pu alors être tracée graphiquement.
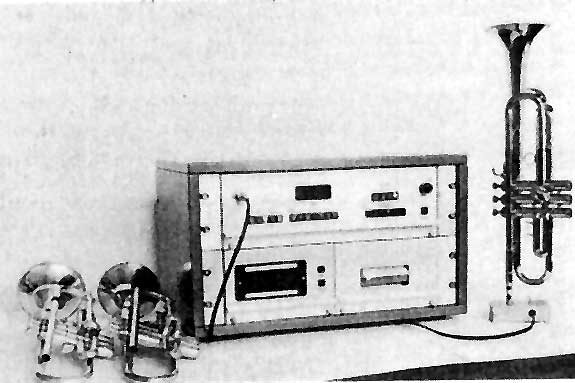
Figure
1 - L'équipement utilisé pour localiser automatiquement
et suivre les résonances d'un instrument à vent.
Une variation
de la longueur de coulisse, de la position des pistons, ou même de
la température
se traduira par un changement de hauteur sur l’afficheur.
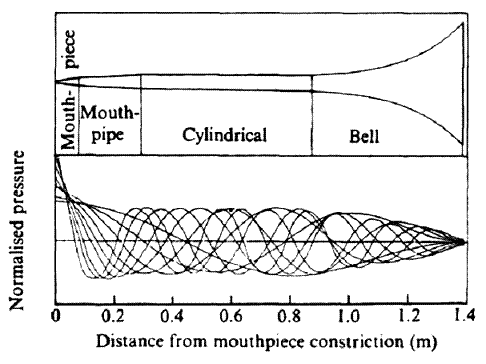
Figure 2 - L’onde
stationnaire de pression du 2ème au 10ème
modes d'une trompette comparée à sa forme physique. (Smith-Daniell
/ Nature).
La figure 2 montre la distribution de pression (pour les 2ème à 10ème
résonances) mesurée sur la longueur d’une trompette en
Sib « à vide » (c’est à dire sans appuyer
de piston, NdT). D'un graphique composé comme celui-ci, on peut
aisément
déduire quelques faits intéressants.
D'abord, le niveau des pressions dépend du diamètre de perce
; par conséquent la région de l'embouchure et de la branche
d'embouchure est bien plus sensible aux changements de perce que la région
du pavillon. Ceci souligne également l'importance d'avoir une queue
d'embouchure bien adaptée au reste de l'instrument.
Deuxièmement, ce diagramme montre seulement neuf des ondes de pression
pour la clarté. En réalité, si les diagrammes de toutes
les notes et harmoniques employées par l'instrumentiste étaient
superposés sur cette figure, l'image deviendrait très embrouillée
avec bien plus de 800 positions nodales le long de la perce de la trompette
! Par conséquent, si les théories de Mahillon et de Blaikley
devaient être appliquées directement à une partie
particulière
de la perce pour la correction d'une seule résonance, il est évident
que plusieurs autres résonances seraient affectées à un
degré plus ou moins grand.
Pour résoudre ce problème, Schilke fait un compromis approximatif
en introduisant quatorze changements de perce abrupts (vus comme des anneaux) à l'intérieur
de ses branches d'embouchure. Cependant, la technique développée
par le Dr. Daniell et moi-même a l'avantage supplémentaire qu'elle
emploie des techniques numériques pour produire la perce la plus lisse
correspondant au changement exigé de la fréquence de résonance.
L'utilisation d'un ordinateur signifie qu'il n'y a pratiquement aucune limite
au nombre de résonances qui peuvent être changées ou
maintenues intactes à volonté.
Les corrections
de perce se font traditionnellement dans la région de
la branche d'embouchure, en partie parce qu'il est bien plus facile et meilleur
marché de produire des mandrins expérimentaux de branche d'embouchure
que des mandrins de pavillon. Notre technique peut être appliquée à n'importe
quelle section (ou sections) de l'instrument et les données peuvent être
converties en mandrins à l'aide de tours à commande numérique.
Des essais antérieurs avec des variations de perce ont apporté l'amélioration
de justesse exigée mais quelques notes souffraient d’une faible
qualité de son et d’une mauvaise réponse. Une étude
de leur spectre tonal a montré un changement de l'équilibre harmonique
dû à ces perturbations, et nous avons constaté que les
résonances qui soutiennent les harmoniques les plus hautes étaient
devenues fausses par inadvertance. En étendant notre
gamme de fréquence
nous avons pu prendre en compte les résonances les plus élevées.
La technique que nous venons de décrire est employée pour apporter
des modifications à la structure des résonances d'un instrument
existant, et n'est pas prévue pour la conception globale d'un instrument.
Les fréquences de résonance et la forme de perce devraient être
connues, bien qu’une grande précision ne soit pas nécessaire
car les données dont nous disposons sur la perce d’une trompette
ont été extrapolées avec succès pour apporter des
améliorations à un trombone basse (Pratt, R.L. Bowsher, J.M.,
Smith, R.A. Nature 271, p. 146-147, 1978).
Plus récemment, j'ai été concerné par le développement
de la trompette Sovereign Studio avec l'aide de Derek Watkins, un des meilleurs
musiciens de studio. Un premier prototype dérivé de la trompette
Sovereign Symphony a montré un défaut de justesse sur le Sol
suraigu (Sol8 à 1568Hz). Cette note mobilise la 13ème résonance
qui n'est pas normalement utilisée dans le répertoire symphonique.
(Étant un nombre premier, cette résonance ne peut même pas être
mobilisée pour soutenir les harmoniques d'une note plus basse.) Dans
ce cas-ci aucun calcul important n'a été nécessaire car
la position des noeuds a suggéré que le trou de la clé d’eau
pouvait introduire une perturbation non désirée ou mal placée.
La solution consistait à combler le trou ou à le déplacer
de 7 mm vers une position plus appropriée. Depuis ce jour, les clés
d’eau ont été traités avec plus de considération
qu’un simple drain !
Le matériau.
On ne peut donner ici qu’une brève discussion de la question très
controversée de l'influence du matériau de paroi sur la couleur
de son et autres qualités de jeu. Essentiellement, un scientifique ne
sera jamais capable de produire une preuve suffisante pour convaincre un instrumentiste
qu’il a tort, qu'il soit pour ou contre. Superficiellement, la littérature
montre un désaccord parmi les chercheurs, mais ceci peut être
attribué à l'utilisation d’instruments et de procédures
différents.
On a entendu des revendications tonitruantes sur les propriétés
acoustiques de divers alliages, particulièrement les plus coûteux
! Les essais que j'ai effectués montrent qu'un panel d’instrumentistes
et d’auditeurs
expérimentés ne peut pas distinguer une trompette avec
pavillon en fibre de verre d’une autre avec pavillon en laiton (de 0,5
mm d’épaisseur
et de mêmes dimensions internes), mais si ce pavillon de fibre de verre
est comparé à un pavillon en laiton plus mince (par exemple 0,3
mm) la différence est tout à fait apparente. Il apparaît également,
en accord avec Wogram (Das Musikinstrument, p. 1193-1194, septembre
1977, et
Instrumentenbau, p. 414-418, mai 1976), que la composition chimique
du pavillon est bien moins importante que son épaisseur, et à mon
avis l'effet de la composition (et de tout traitement thermique) n’a
d’influence
qu’avec des parois minces.
En testant un trombone ténor avec son répertoire symphonique,
Wogram a conclu que « les pavillons à parois extrêmement
minces s'avèrent offrir les plus mauvaises caractéristiques de
réponse. » Ceci, naturellement, n'infirme pas nécessairement
les commentaires des instrumentistes concernant des trompettes ou des trombones
utilisés avec d'autres musiques.
Comme beaucoup de musiciens de studio et de variétés m'ont demandé de
faire des pavillons plus minces, il m’a semblé qu'il devait y
avoir une bonne raison à cette demande. En utilisant une technique holographique
(avec des lasers) au Laboratoire National de Physique, j’ai pu observer
les vibrations pour des pavillons de diverses épaisseurs. La figure
3 montre un exemple de vibration de deux pavillons, de 0,3 mm et 0,4 mm d’épaisseur.
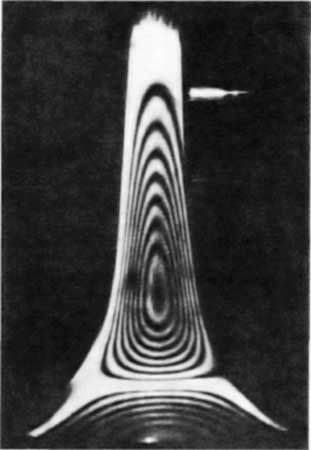
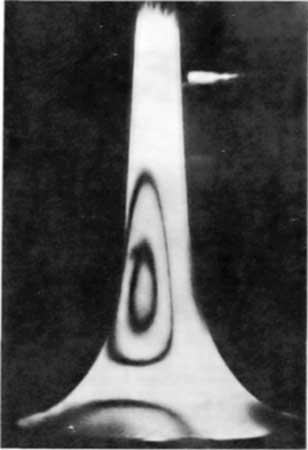
Figure 3 — Reconstitution holographique des vibrations du pavillon.
A gauche : épaisseur de paroi de 0,3 mm approximativement. A droite : épaisseur
de paroi de 0,4 mm approximativement. (Copyright Crown, N.P.L)
Le nombre d'anneaux (ou de lignes) indique le degré de vibration. Quand plusieurs pavillons de différentes épaisseurs sont mesurés, il est possible de tracer un graphique (Figure 4) prouvant que la quantité de vibration augmente rapidement avec seulement un petit changement d'épaisseur. (les calculs sont conformes à cette courbe, où la vibration est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de l'épaisseur du matériau.).
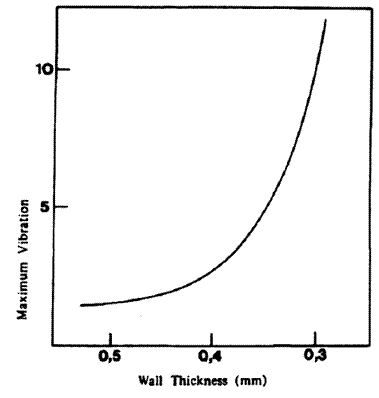
Figure 4 - Augmentation
rapide de la vibration des parois avec la diminution de leur épaisseur
Du point de vue du jeu, cette
vibration du matériau
semble accentuer les fréquences les plus élevées et
améliorer la
réponse dans le registre supérieur. Nous avons entrepris des
recherches complémentaires pour mieux comprendre ce phénomène.
Pour finir, quelques mots sur la construction, car l'ergonomie de la trompette
est aux premiers rangs des exigences des instrumentistes.
En se rendant compte que plusieurs de nos clients maintiennent leurs instruments
sur les lèvres pendant de longues périodes, le poids a été considéré comme
un facteur très important. À 940 grammes, nos instruments sont
parmi les trompettes en Si bémol les plus légères actuellement
disponibles sur le marché. Deuxièmement, la distribution du
poids est tout aussi importante, aussi l'équilibre a été soigneusement
ajusté. Un grand soin a été également pris dans
le positionnement des anneaux, le centrage des piston et l'action mécanique.
Des petits détails peut-être, mais tous destinés à aider
l'instrumentiste à oublier son instrument et à se concentrer
sur la production d’une belle musique.
L'auteur de cet article, le Dr. Richard Smith a
des diplômes de recherche
dans la conception acoustique des instruments bois et cuivres, et a été pendant
12 ans le concepteur en chef chez Boosey et Hawkes Ltd. Avec sa propre entreprise à Londres,
il applique maintenant cette large expérience à la conception
des cuivres pour différents instrumentistes. Le Dr. Smith est également
un musicien compétent et joue régulièrement du contrebasson à Londres.
Richard Smith (Musical Instruments) Ltd 110 The Vale London N14 6AY