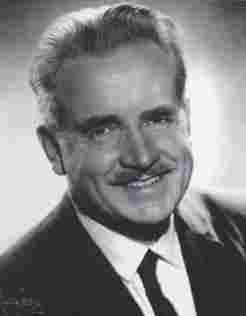 Physique
des cuivres et effets acoustiques des divers matériaux et de leur traitement
Physique
des cuivres et effets acoustiques des divers matériaux et de leur traitementPar Renold Otto Schilke
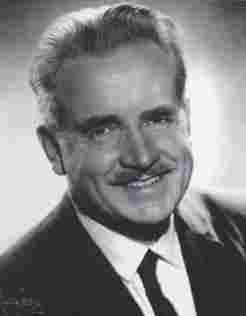 Physique
des cuivres et effets acoustiques des divers matériaux et de leur traitement
Physique
des cuivres et effets acoustiques des divers matériaux et de leur traitement
Par Renold Otto Schilke
(Traduction d'un article, probablement le texte
d'une conférence, diffusé par la société Schilke
et consultable sur le site The
Schilke Loyalist*. Les intertitres sont du traducteur.)
Comment construire un instrument juste.
La forme interne d'un instrument en cuivre et de son embouchure a toujours intéressé
fortement non seulement les facteurs d'instruments en cuivre, mais aussi ceux
qui les jouent. Les harmoniques d'un tuyau ouvert, si le diamètre intérieur
est constant, ne peuvent être utilisés comme des notes de la gamme
tempérée sans l'usage d'une coulisse d'accord. De nombreux fabricants
ont constaté qu'en plaçant des portions de sections coniques,
on peut se rapprocher des notes de la gamme usuelle. Par essais successifs et
de façon empirique, ils ont obtenu une forme de tube permettant de produire
des instruments utilisables. Au siècle dernier, le belge Victor Mahillon
a montré qu'on peut contrôler la position des nœuds de pression
de façon à ajuster la hauteur de chaque résonance, permettant
ainsi de créer une série de notes utilisables. Sa méthode
consiste à modifier la section du tube au voisinage des nœuds de
pression de façon à obtenir la hauteur voulue.
Expliquons d'abord ce qui se passe quand une impulsion d'énergie est
créée par l'expulsion d'air sous pression par les lèvres
qui entrent en vibration. L'air entre en vibration dans la cuvette de l'embouchure.
C'est pourquoi la forme de la cuvette est si importante pour obtenir le son
que désire l'instrumentiste. L'air atteint sa pression maximale dans
le "grain" (la partie la plus resserrée de l'embouchure, entre la cuvette
et la queue), où se crée la structure vibratoire de l'air contenu
dans l'instrument, comme se crée la structure vibratoire de la corde
d'un violon au point de contact de l'archet. A la sortie du pavillon de l'instrument,
la pression de l'air est constante, ce qui crée une onde stationnaire
qui s'établit en retour jusqu'au larynx de l'instrumentiste. C'est pourquoi
des instrumentistes ayant des cavités buccales différentes obtiennent
des hauteurs de son différentes d'un même instrument. J'en ai eu
un bon exemple quand M. Arnold Jacobs et M. A. Hirada (du Japon) essayèrent
des tubas dans mon studio. Pour jouer à la même hauteur, M. Jacobs,
qui a une cavité buccale très large, devait rentrer la coulisse
d'accord à fond tandis que M. Hirada, dont la cavité buccale est
très petite, la tirait de façon à allonger le tube de vingt
centimètres.
En cherchant une méthode pour déterminer la forme de tube optimale,
j'ai d'abord essayé l'approche théorique. J'ai donc dessiné
pendant plusieurs années les structures nodales de la trompette, les
superposant sur des calques pour trouver les endroits exacts où se produisent
les nœuds et les ventres de pression pour chaque note. En effet, c'est
là qu'il faut agir pour corriger une note, mais s'il s'agit d'un point
commun à plusieurs notes, la correction favorable pour l'une peut être
défavorable pour les autres. Mais quand j'ai essayé d'appliquer
cette théorie, je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Si
je n'avais affaire qu'à des tubes cylindriques, la méthode aurait
pu s'appliquer, mais comme l'embouchure et le pavillon ont des formes particulières,
il aurait fallu développer une nouvelle formule pour chaque section de
l'instrument.
C'est alors que je rencontrai le Dr. Aebi et que nous eûmes une discussion
sur ce sujet. Vous savez que le Dr. Aebi est un corniste amateur et peut-être
un des plus grands physiciens. Il avait essayé de localiser la structure
nodale du cor en déroulant complètement l'instrument et en insérant
un petit microphone au bout d'une baguette pour enregistrer le signal sur un
oscilloscope pendant l'émission d'un son. Dans son laboratoire, nous
avons commencé par utiliser un micro de contact de façon à
travailler avec l'instrument sous sa forme normale, pendant qu'un instrumentiste
jouait une note donnée. En déplaçant le micro le long de
l'instrument jusqu'à la cavité buccale du musicien, et en filmant
les oscillogrammes avec une caméra, nous avons pu déterminer précisément
les nœuds et les ventres de pression. A l'emplacement d'un ventre de pression
pour une note donnée, il serait possible de maintenir cette note inchangée
même si on enlevait une section du tube à cet endroit précis.
J'en ai souvent donné la démonstration avec une trompette en ut.
Quand on joue un sol 2ème ligne sur une trompette en ut, il
y a un nœud de pression au niveau de la clé d'eau, et si on l'ouvre,
la vibration s'arrête. Si on joue le do au dessus, la clé d'eau
est entre un nœud et un ventre et quand on l'ouvre, le son monte d'un ton
si bien qu'on peut l'utiliser pour triller. Si on joue le mi au dessus, le son
est inchangé que la clé soit ouverte ou non. En fait, à
cet endroit, on pourrait enlever 15 mm de tube de l'instrument sans que cela
change quoi que ce soit pour cette note particulière.
Je sais qu'il est difficile de croire qu'on peut changer la hauteur d'un instrument
simplement en changeant la section du tube de quelques centièmes de millimètre
à l'endroit exact du nœud de pression de la note que l'on veut affecter.
Si vous examinez attentivement l'intérieur de la branche d'embouchure
de mon instrument, vous verrez que j'ai corrigé les notes fautives en
quatorze endroits différents. A certains endroits, la note est corrigée
de presque un huitième de ton en faisant varier la section de moins d'un
millième sur une longueur de six millimètres. Comme indiqué
précédemment, on ne peut corriger la hauteur d'une note qu'à
certains endroits. Il faut trouver un point qui corresponde à un nœud
de pression pour cette seule note. Si cet endroit correspond à plusieurs
notes, elles seront affectées de façon incorrecte. Certaines des
corrections se font au niveau du pavillon. On ne peut pas faire les corrections
sur les coulisses correspondant aux trois pistons, mais on le peut sur la coulisse
d'accord, et c'est aussi la raison pour laquelle on trouve sur mes instruments
des branches d'embouchure aussi longues, plus longues que chez les autres facteurs
d'instruments.
J'espère que j'ai été clair dans cette approche de la physique
interne des cuivres, mais je sais aussi que c'est difficile à admettre
la première fois. Quand j'ai présenté ces résultats
à Hamamatsu, pour en faire une démonstration très frappante,
j'ai fait construire un orgue à tuyaux d'une octave avec tous les tuyaux
exactement de la même longueur. En ajustant les proportions internes des
tuyaux et la section aux nœuds de pression, j'ai pu produire un gamme complète
sur une octave.
Il est important aussi dans la construction d'un instrument en cuivre de ne
pas mettre d'entretoise soudée n'importe où, en particulier sur
les nœuds de pression multiples. Même avec le peu d'entretoises que
j'ai placées sur mes instruments à accord par le pavillon, deux
notes sont affectées. Bien sûr, elles varient selon la tonalité
de l'instrument. Certaines trompettes, telles que les trompettes en mi bémol
à accord par le pavillon et les trompettes en sol et en fa, peuvent être
jouées par la majorité des instrumentistes sans utiliser la coulisse
mobile. Pour comprendre comment c'est possible, reportez vous à mes explications
précédentes.
Importance du choix du métal et de son traitement.
Parlons maintenant quelques minutes des matériaux et de leur effet sur
l'acoustique des cuivres. La majorité des pavillons des cuivres sont
constitués de diverses sortes de laiton, composées de cuivre et
d'autres métaux, selon les caractéristiques recherchées.
La composition usuelle contient du cuivre, de l'étain et un peu d'antimoine
pour la dureté. Certains utilisent du cuivre, du zinc et de l'étain.
Après avoir expérimenté sur mes instruments, ma formule
favorite jusqu'à une date récente était une combinaison
de 60% de cuivre et 40% d'argent qui était spécialement faite
pour moi, uniquement pour les pavillons de mes instruments. Mais il y a un an
environ, j'ai trouvé une nouvelle formule que j'appelle "bronze de béryllium".
Ce matériau particulier a un effet acoustique remarquable par sa capacité
à transmettre l'énergie. Sa projection du son est absolument phénoménale.
Mais voyons les différents métaux que nous avons expérimentés.
Nous avons monté une expérience dans laquelle nous avons utilisé
de l'acier, de l'aluminium, des matières plastiques variées, du
verre, de l'argent, différentes sortes de laiton et enfin du plomb. Pour
en donner les résultats aussi brièvement que possible, je choisirai
les deux extrêmes. Le pavillon en acier, qui était trempé
pour être extrêmement dur, a donné peut-être un des
résultats les plus intéressants. Beaucoup de gens testent un pavillon
en le frappant avec le doigt ou l'ongle, et en frappant le pavillon en acier,
il émettait un son très clair, comme une clochette. Mais en jouant
de l'instrument, le son était extrêmement mat. En recherchant la
raison, nous avons regardé l'oscilloscope pendant que l'instrumentiste
jouait et constaté que le spectre de vibration du pavillon écrasait
la structure harmonique du son lui-même. A l'autre extrémité
était le pavillon en plomb. Ce pavillon, frappé du doigt, émettait
un son très mat ressemblant à celui d'un morceau de bois. Mais
le son qui en émanait quand l'instrument était joué était
extrêmement brillant au point de paraître artificiel. Cela apparaissait
sur l'oscilloscope comme une structure harmonique parfaite, sans aucune distorsion,
et il en résultait un son absolument pur mais musicalement inutilisable,
sauf pour des effets spéciaux comme les produiraient certains instruments
électroniques. Le son présente normalement des harmoniques au-dessus
et au dessous de la fondamentale, visibles sur un oscilloscope. Ces "distorsions",
si on peut les appeler ainsi, donnent de la "chaleur" au son. Ces distorsions
sont nécessaires pour que le son soit accepté comme "musical"
par nos oreilles.
Pour continuer la discussion sur les matériaux qui composent un cuivre,
il faut parler aussi du traitement du métal après sa mise en forme
de pavillon. Pour l'ensemble de l'instrument, plus il est inerte aux vibrations,
meilleur il est. Cependant, l'épaisseur et la dureté du métal
de la branche d'embouchure, de la coulisse d'accord et du pavillon affectent
considérablement la qualité du son produit par l'instrument. Par
exemple, avec un laiton de formule 70/30 ou 80/20, il est nécessaire
après mise en forme du pavillon de le recuire en deux endroits différents,
cela pour corriger la dureté excessive causée par le martelage
du pavillon chaudronné. Si on le laissait tel quel, le son serait très
sombre (rappelez vous les résultats obtenus avec un pavillon en acier
trempé). Le métal trop dur produit trop de vibrations propres.
En ce qui concerne l'épaisseur d'un pavillon en laiton normal, je préfère
que les zones critiques aient moins de 0,35 mm d'épaisseur, en fait entre
0,30 et 0,35 mm. Par contre, avec le bronze de béryllium, je peux faire
des pavillons dont les zones critiques font moins de 0,17 mm et en particulier
un pavillon que j'ai terminé pour M. Faddis de New York fait moins de
0,07 mm. Ce pavillon particulier lui convient particulièrement bien dans
la mesure où il joue la plupart du temps dans l'extrême aigu. La
réponse est excellente pour ce genre de travail. En d'autres termes,
tout dépend de l'usage que l'on veut en faire et du type de son que l'instrumentiste
recherche. Tout cela détermine la façon exacte dont un pavillon
doit être construit. Comme vous le voyez, beaucoup de choses influencent
les propriétés acoustiques d'un instrument en cuivre.
Venons en à la controverse permanente entre ceux qui préfèrent
les instruments vernis et ceux qui les préfèrent
argentés ou dorés, ou encore ceux qui préfèrent
les instruments en laiton brut sans aucun traitement de finition. Voici mes
conclusions sur les trois types de finition. J'ai commencé par choisir
moi-même trois instruments qui jouaient de façon absolument identique.
J'en ai argenté un, j'ai fait faire un très bon vernis sur le
second et j'ai laissé le troisième à l'état brut.
J'insiste sur le fait que ces trois instruments jouaient de façon identique
au départ, autant qu'il est possible. Plusieurs trompettistes de l'orchestre
symphonique ont participé aux tests, ainsi que d'autres trompettistes
professionnels de Chicago, et ils ont tous été d'accord sur les
résultats. La conclusion a été que l'argenture n'affecte
pas les qualités de jeu d'un cuivre, c'est à dire que l'instrument
argenté et l'instrument laissé en laiton brut jouaient de façon
identique. L'instrument verni paraissait avoir changé de façon
importante. Alors qu'à l'origine il était identique aux deux autres,
sa qualité de son était dégradée et son accord général
était modifié.
Pour expliquer ces conclusions, c'est à dire pourquoi l'instrument argenté
et l'instrument non traité jouaient identiquement, contrairement à
l'instrument verni, laissez moi vous donner quelques chiffres. L'épaisseur
d'argent sur un instrument argenté est seulement de un centième
de millimètre. Un vernis bien réalisé fait environ 0,15
mm d'épaisseur. Maintenant, pour avoir une base de comparaison, une feuille
de papier ordinaire fait environ 0,08 mm d'épaisseur, donc la couche
d'argent fait 1/8ème de l'épaisseur d'une feuille de
papier, alors que le vernis a une épaisseur double. L'argent lui-même
est parfaitement compatible avec le laiton. Le vernis, si c'est un bon vernis
cuit au four, est presque aussi dur que du verre et pas du tout compatible avec
le laiton. Le vernis sur le pavillon d'un instrument fait 0,15 mm à l'extérieur
et autant à l'intérieur, ce qui donne une épaisseur totale
de 0,3 mm. C'est presque l'épaisseur du métal de mes instruments,
et donc le vernis va presque doubler l'épaisseur du pavillon. Vous voyez
donc qu'il ne peut qu'affecter la qualité de jeu de l'instrument.
Importance de la précision d'usinage.
Voilà pour les matériaux entrant dans la fabrication de l'instrument.
Maintenant, passons au point suivant qui est peut-être le plus important,
l'étanchéité des pistons. Vous connaissez les bois et l'importance
pour la justesse de l'étanchéité du tamponnage. C'est la
même chose pour les cuivres. S'il y a la moindre fuite aux pistons, à
la clé d'eau ou à une soudure, cela produira un effet certain
sur la justesse. C'est le résultat d'une perturbation de la structure
nodale de la vibration. A l'emplacement d'une fuite, il se produit une turbulence
qui crée un nœud de pression et établit une onde stationnaire
qui affecte la justesse.
Je pense que la tolérance d'ajustage des pistons doit être inférieure
au millième, c'est à dire un demi-millième de part et d'autre
du piston. Cela permet un jeu libre et donne de bonnes qualités acoustiques
à l'instrument. Si l'instrument n'est pas complètement étanche,
tout ce que nous avons dit jusqu'ici est sans objet. Toute correction faite
sur l'instrument par variation de la section du tube est inefficace si l'instrument
n'est pas absolument étanche.
Maintenant, ça ne veut pas dire que je crois essentiel
que l'air traverse l'instrument. Ça ne l'est pas ! Si, après que
les lèvres soient entrées en vibration, l'air pouvait être
dirigé ailleurs qu'à travers l'instrument, le son serait optimal.
Ceux qui comprennent la physique le savent. Cependant, il y a des gens qui ne
le comprennent pas. J'ai posé la question un jour où je donnais
une consultation à des membres d'un orchestre, après avoir entendu
leurs diverses considérations sur l'air qui devait traverser l'instrument.
Je leur demandais "est-il nécessaire à la production du son que
l'air transporte le son à travers l'instrument ?". Tous acquiescèrent.
Pour effectuer ma démonstration, j'ai fait venir un tubiste sur la scène,
lui ai fait souffler de la fumée dans son instrument puis en jouer. Il
joua plus d'une minute avant que de la fumée apparaisse à la sortie
du pavillon. En conclusion, il faut de l'air dans l'instrument pour que s'établisse
la structure vibratoire. Il n'est pas nécessaire que l'air se déplace
plus dans l'instrument que l'eau dans un étang lorsqu'on y jette une
pierre. L'impulsion d'énergie se propage avec l'onde dans l'eau. C'est
la même chose avec le son et l'air. Le son sort de l'instrument et se
propage de la même manière.
Je sais que j'ai évoqué beaucoup de thèmes qui sont encore
controversés. Mais je déteste affirmer quelque chose avant de
l'avoir étudié et prouvé, non seulement à moi-même
mais aussi à de nombreux musiciens de premier plan. J'espère que
les faits que j'ai rapportés vous auront intéressés.
Renold O. Schilke
(traduit en 2001 par Joël Eymard)